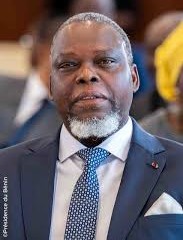La justice tunisienne a rendu son verdict dans le cadre du procès très suivi dit du « complot 2 ». Le mardi 8 juillet 2025, plusieurs responsables politiques ont été lourdement condamnés, accusés de manœuvres visant à porter atteinte à la sécurité intérieure. Rached Ghannouchi, figure de proue du parti Ennahda, écope de 14 ans de prison.
Déjà détenu, l’ancien président de l’Assemblée a boycotté l’audience. Il est visé par plusieurs procédures similaires, dont une précédente condamnation à 22 ans en février. Cette fois, les autorités judiciaires l’accusent, aux côtés d’autres membres de son parti, d’avoir mis en place une structure sécuritaire parallèle liée à Ennahda.
Vingt personnalités étaient poursuivies dans cette affaire. Parmi les condamnés figurent Rafik Abdessalem, ancien ministre et gendre de Ghannouchi, ainsi que Nadia Akacha, ex-cheffe de cabinet du président Kaïs Saïed. Jugés par contumace, ils écopent chacun de 35 ans de réclusion. Tous deux se trouvent hors du pays.
Les poursuites reposent sur des chefs d’inculpation graves, comme la participation à une organisation terroriste et l’atteinte à la sûreté nationale.
Ce jugement s’inscrit dans une période de tensions politiques persistantes en Tunisie, amorcée par la décision de Kaïs Saïed, en juillet 2021, de suspendre le Parlement et de centraliser le pouvoir. Une manœuvre décriée par ses opposants comme un virage autoritaire.
De nombreuses organisations de défense des droits humains dénoncent une recrudescence des arrestations visant les opposants, les journalistes et les figures de la société civile. Selon elles, le cadre légal, notamment sur les fausses informations, est utilisé pour restreindre les libertés et museler les voix dissidentes.