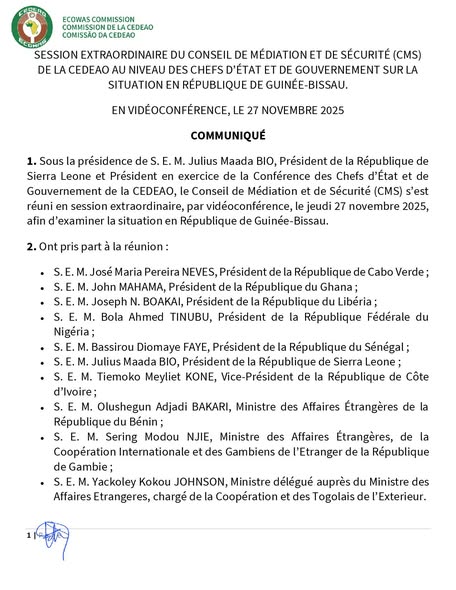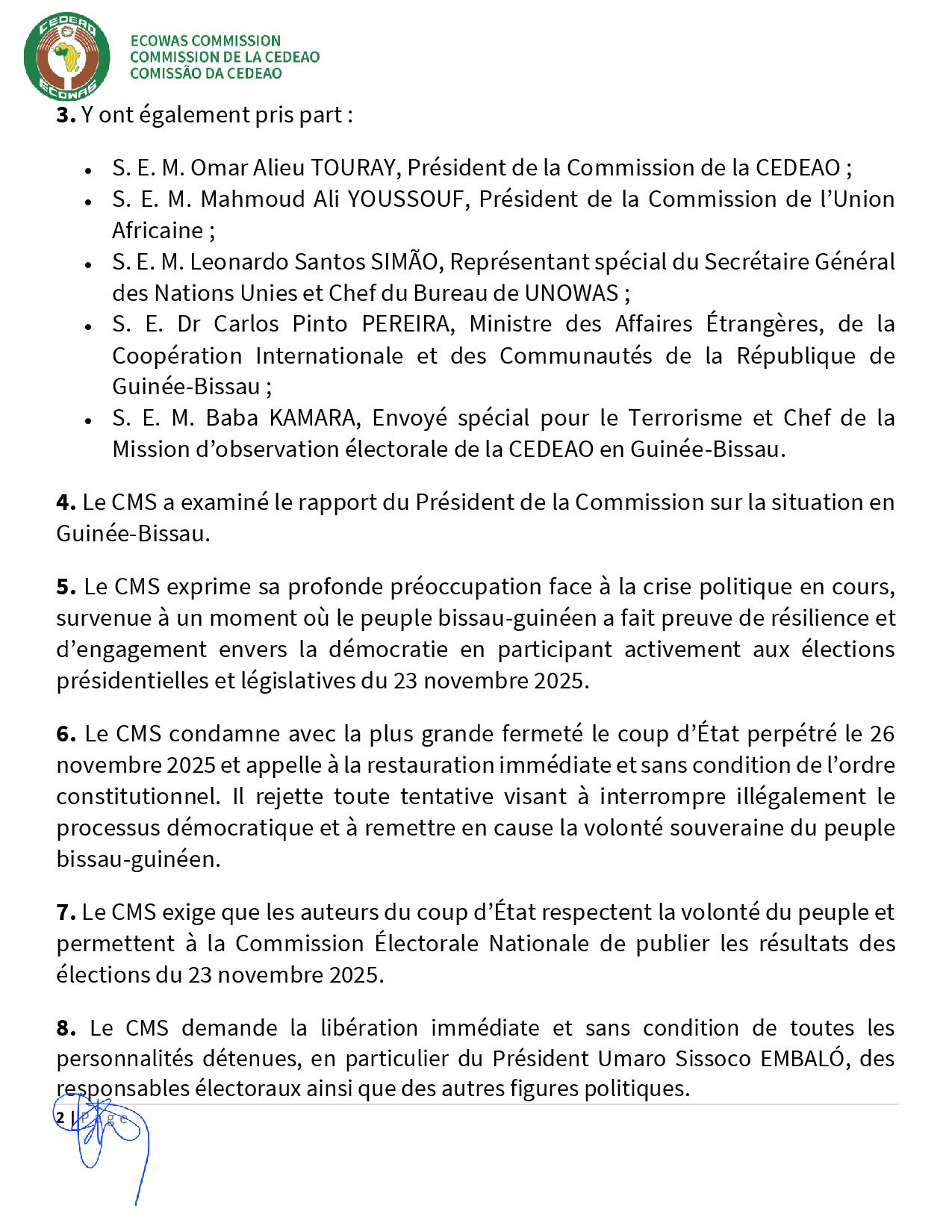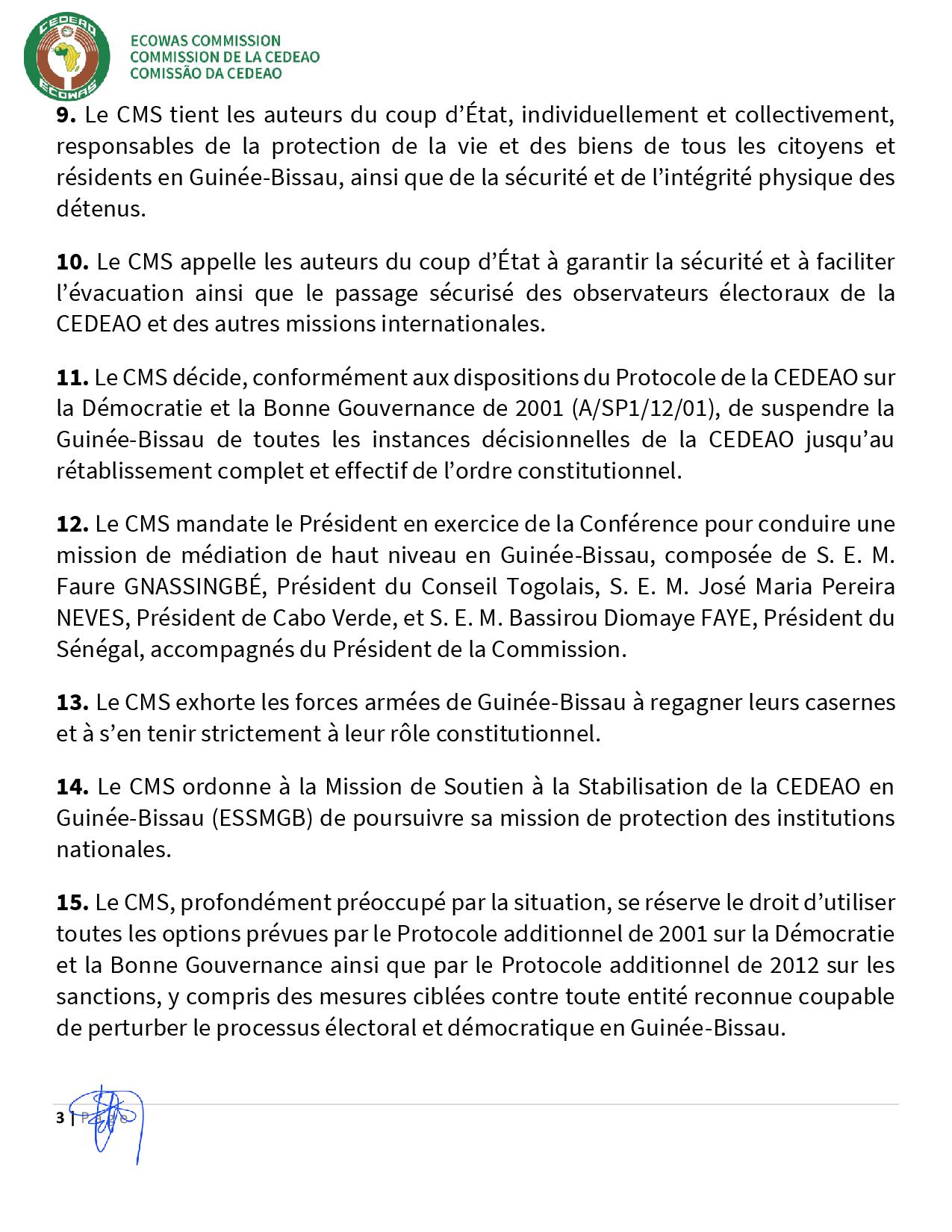La Guinée-Bissau replonge dans l’instabilité politique avec un nouveau coup d’État militaire, survenu le 26 novembre 2025. Ce putsch, qui est intervenu quelques heures avant l’annonce des résultats de l’élection présidentielle du 23 novembre, a entraîné la destitution du président Umaro Sissoco Embaló, candidat à sa réélection.
L’armée, sous la bannière du « Haut Commandement militaire pour la restauration de l’ordre », a investi le général Horta N’Tam comme président de transition pour un an, promettant de lutter contre le narcotrafic et de restaurer la stabilité. Plusieurs responsables politiques et militaires, dont l’ancien Premier ministre Domingos Simões Pereira, ont été arrêtés. Le président déchu Embaló a été exfiltré vers le Sénégal, où il est arrivé sain et sauf, grâce à une opération coordonnée par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye.
Depuis son indépendance du Portugal, la Guinée-Bissau a connu quatre coups d’État réussis et seize tentatives, ainsi qu’une guerre civile majeure, faisant des putschs un instrument récurrent du pouvoir politique. Les précédents incluent le renversement de Luís Cabral par Joao Bernardo Vieira en 1980, la guerre civile déclenchée par la tentative de coup manqué d’Ansumane Mané en 1998, et la destitution de Kumba Ialá par le général Veríssimo Correia Seabra en 2003.
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a condamné ce nouveau coup d’État et suspendu la Guinée-Bissau de tous ses organes décisionnels jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel. Une mission de médiation, conduite par les présidents Faure Gnassingbé (Togo), Jose Maria Pereira Neves (Cap-Vert) et Bassirou Diomaye Faye (Sénégal), a été mandatée pour négocier avec les putschistes et garantir la proclamation des résultats électoraux.
Ce cinquième coup d’État confirme que l’instabilité politique reste profondément enracinée en Guinée-Bissau, un pays encore marqué par l’héritage colonial portugais et un cycle récurrent de tensions qui entravent les efforts de démocratisation et de développement.
Le Chapelait de sanction de la CEDEAO