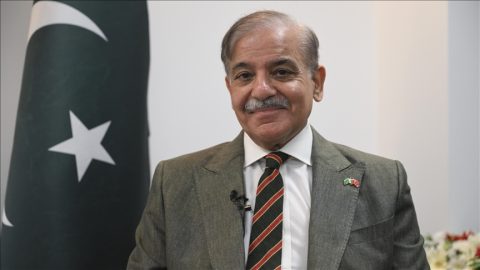À l’aube, sur l’étang de l’Ayrolle à Gruissan (Aude), le pêcheur Sébastien Gaubert relève ses lignes. Après quinze ans sur cette lagune, il ne ramène plus que quelques bars, et l’anguille, jadis abondante, se fait rare. Classée en danger critique d’extinction depuis 2008, elle assurait autrefois près de 40 % des revenus des pêcheurs.
La cause principale : une salinité en hausse, conséquence de la sécheresse persistante et du manque de pluie. « L’anguille a besoin d’eau saumâtre, pas trop salée », rappelle le pêcheur. Or, selon l’Ifremer, la salinité médiane des lagunes méditerranéennes est passée de 33 à 37 unités en vingt ans, et celle de l’Ayrolle pourrait atteindre 44 dès 2025.
Ces lagunes, situées entre les rivières et la mer, réagissent plus vite que la Méditerranée aux variations climatiques. L’apport d’eau douce y transporte aussi nutriments et phosphore, accélérant la prolifération d’algues. Trop riche, le milieu s’étouffe : l’oxygène chute et la vie marine dépérit, un phénomène appelé « malaïgue ».
Les données de l’Ifremer confirment la tendance : l’oxygène de l’Ayrolle est passé de 8 à 6 mg/L depuis 2000, frôlant le seuil critique de 5 mg/L. Pour les chercheurs, ces mutations font des lagunes de véritables « sentinelles » du réchauffement climatique, révélant par avance ce que pourrait devenir la Méditerranée tout entière.