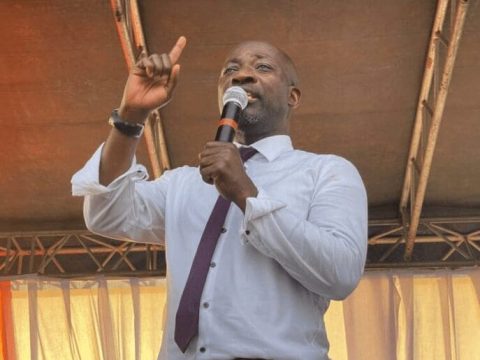Un collectif international de scientifiques relance le débat sur notre consommation de viande. Déjà en 2019, ces experts avaient préconisé une réduction drastique de la viande rouge dans l’alimentation, suscitant la colère des industriels. Six ans plus tard, ils confirment leurs conclusions dans une nouvelle étude publiée le 3 octobre dans The Lancet, s’appuyant sur des données encore plus robustes.
Selon leurs travaux, la consommation de viande rouge reste associée à une hausse de la mortalité dans les pays développés où elle demeure élevée depuis des décennies. Les chercheurs proposent un régime dominé par les aliments d’origine végétale, avec une présence limitée mais non nulle de produits animaux. Leur objectif : concilier santé publique et durabilité environnementale.
Le fameux « régime de santé planétaire », déjà présenté en 2019, fixait la part de viande rouge à 14 grammes par jour, soit deux fois moins que la moyenne mondiale et très en deçà des habitudes occidentales. Les experts privilégient plutôt céréales complètes, fruits, légumes, noix et oléagineux. Malgré la polémique suscitée à l’époque, la communauté scientifique avait globalement accueilli favorablement ces recommandations, même si certaines critiques soulignaient leur manque d’adaptation aux inégalités sociales.
Entre-temps, des enquêtes ont montré que des acteurs de l’agroalimentaire avaient mené des campagnes de désinformation pour discréditer ces travaux. Malgré ces résistances, les chercheurs publient aujourd’hui une mise à jour de leurs préconisations, intégrant cette fois des dimensions sociales comme la dignité des travailleurs du secteur.
Les ajustements restent minimes : la limite de viande rouge est fixée à 15 grammes par jour, tandis que les apports conseillés atteignent 200 g pour les légumes, 300 g pour les fruits, 210 g pour les céréales complètes, 250 g pour les produits laitiers, et 30 g pour le poisson ou la volaille. Ces repères ne changent pas fondamentalement la ligne de 2019.
Pour François Mariotti, professeur de nutrition à AgroParisTech, cela n’a rien d’étonnant : « Nos connaissances sur les liens entre alimentation et santé n’ont pas radicalement évolué depuis 2019 ». Les auteurs admettent toutefois qu’un respect strict de leurs fourchettes basses pourrait provoquer, chez certains individus, des carences temporaires.