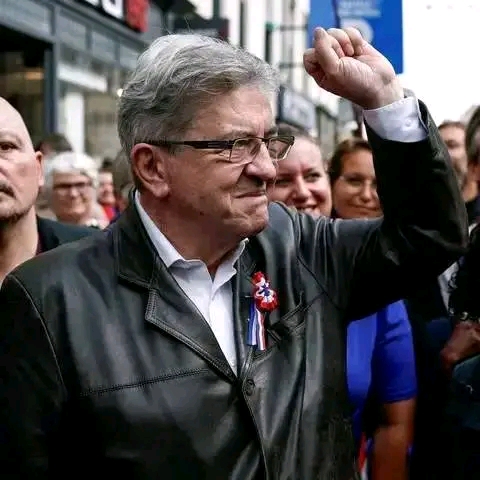L’Algérie a mis en vigueur, le 10 août 2025, une nouvelle loi minière censée moderniser le secteur et attirer des capitaux étrangers. Adopté en juillet, le texte redéfinit le cadre juridique, mais conserve plusieurs contraintes qui pourraient freiner son impact réel dans une économie encore dépendante des hydrocarbures.
La loi 25-12 réserve les autorisations de prospection et les permis d’exploration aux sociétés de droit algérien, même lorsqu’elles appartiennent en tout ou partie à des étrangers. L’exploitation des mines reste également conditionnée à cette exigence. Si la règle 49/51 est supprimée pour les mines, elle demeure pour les carrières, dont le capital doit rester majoritairement algérien.
L’article 101 fixe à 20 % la participation minimale de l’entreprise nationale dans les projets miniers détenus par des investisseurs étrangers. Cette part ne peut être réduite lors d’augmentations de capital, sauf décision expresse de l’entreprise nationale, mais elle peut être relevée en cas d’« intérêt économique avéré ».
La loi introduit aussi la possibilité d’une exploitation artisanale pour tout citoyen algérien sur un périmètre libre et à faible profondeur, sous contrôle de l’Agence nationale des activités minières. Toutefois, les contraintes techniques et financières laissent planer le doute sur son développement.
Les sanctions sont strictes : de deux mois à deux ans de prison et jusqu’à 13 640 euros d’amende pour prospection illégale ; d’un à trois ans et jusqu’à 20 460 euros pour exploitation sans titre ; et jusqu’à un an et 6 820 euros pour fouilles ou ventes non autorisées de minéraux, fossiles ou météorites.
Malgré un discours officiel axé sur la modernisation et l’ouverture, le maintien de verrous structurels, l’obligation de participation publique et le poids de la bureaucratie pourraient réduire l’attractivité du secteur pour les investisseurs étrangers, faisant craindre que la réforme reste plus symbolique qu’opérationnelle.