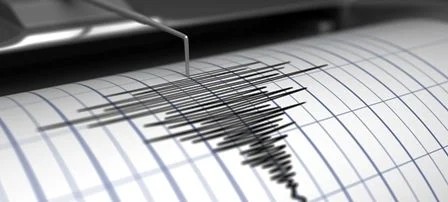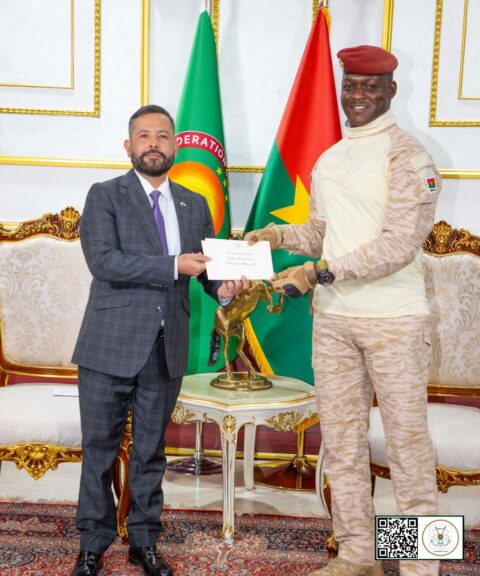Depuis le dimanche 27 juillet, une loi adoptée en Algérie suscite de vives inquiétudes. Publiée au Journal officiel, cette nouvelle législation encadre officiellement la transition de l’état de paix à celui de guerre. Elle consacre une vision assumée d’un État constamment en alerte, prêt à activer l’ensemble de ses ressources pour faire face à toute menace jugée sérieuse.
Le texte prévoit une mobilisation globale de l’appareil étatique : armée, administration, économie, finances, et main-d’œuvre peuvent être réquisitionnées si l’intégrité territoriale, l’indépendance ou les institutions constitutionnelles sont perçues comme mises en danger. Un simple décret présidentiel suffit à enclencher cette transformation complète, sans garde-fous clairement établis. Ce flou juridique nourrit les critiques d’experts qui redoutent une dérive autoritaire.
Pour de nombreux analystes et diplomates, cette loi confirme les signaux préoccupants déjà émis depuis des années : Alger se replie dans une logique de confrontation constante. Le pouvoir algérien, sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune, semble conforter l’image d’un régime enfermé dans une lecture anxiogène du monde, où la guerre devient une grille d’analyse permanente.
Le timing interroge. La promulgation intervient au moment où la zone sahélienne s’enfonce dans l’instabilité, avec une présence occidentale en retrait, une militarisation croissante de l’AES et des tensions ravivées avec le Maroc. Dans ce contexte explosif, l’Algérie s’arme désormais d’un cadre juridique qui lui permettrait de réagir rapidement à tout incident, réel ou construit.
Au fond, ce virage s’inscrit dans une stratégie plus globale. Face à l’absence de réponses concrètes aux attentes sociales et économiques, les autorités semblent préférer le registre de la menace extérieure pour fédérer la population et renforcer le contrôle. En évoquant des dangers imminents, elles justifient le renforcement des capacités militaires, tout en consolidant leur pouvoir.
Mais cette posture comporte des risques. Dans une région déjà traversée par de multiples foyers de tension, toute légalisation de l’état de guerre dépasse la simple démarche administrative. Elle modifie les équilibres diplomatiques, alimente les soupçons, et augmente les probabilités d’un embrasement. Le choix d’Alger, loin de rassurer, fait craindre une instabilité renforcée dans un Maghreb-Sahel déjà fragilisé.