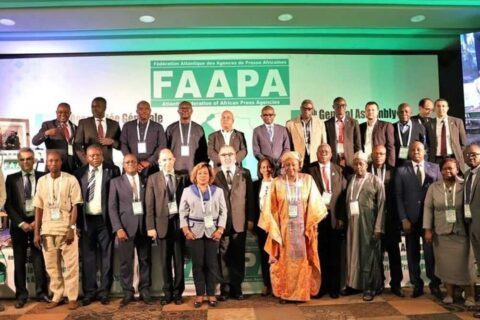Six ans après leur introduction, les banques islamiques marocaines ont franchi un cap historique : elles ont atteint l’équilibre financier en 2024. Cette première, annoncée par Bank Al-Maghrib, confirme l’enracinement progressif de la finance participative dans le paysage bancaire national.
Depuis leur lancement officiel en 2018, ces établissements (appelés « banques participatives ») ont connu une croissance continue, portée par la demande croissante en produits financiers conformes à la charia. Fin 2024, le volume total des financements octroyés par le secteur atteignait 33,8 milliards de dirhams, soit environ 3,1 milliards d’euros. La quasi-totalité (près de 79 %) concerne des prêts immobiliers via la formule Mourabaha, illustrant la faible diversification actuelle de l’offre.
Parallèlement, les ressources mobilisées ont fortement progressé. En 2023, les dépôts des clients ont bondi de 30,5 %, atteignant 15,8 milliards de dirhams (1,45 milliard d’euros). Ce dynamisme ne masque cependant pas les déséquilibres : le déficit de financement, évalué à 9,7 milliards de dirhams, a été comblé grâce à des solutions internes comme les contrats wakala bil istithmar ou encore le soutien direct des maisons mères.
Les indicateurs de performance sont rassurants : le ratio de liquidité à court terme s’établit à 195 %, bien au-dessus des exigences, et le ratio de solvabilité atteint 16,2 %, avec 13,5 % de fonds propres de catégorie 1. Sur le plan territorial, le réseau s’est densifié : 206 agences maillent désormais le pays, avec une concentration notable dans les régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès, qui rassemblent 64 % des implantations.
Le secteur emploie 1 228 salariés, dont plus du tiers sont des femmes. Cette croissance de l’emploi (+21,2 % en un an) accompagne une structuration plus affirmée. Mais la finance islamique marocaine reste encore marginale dans l’écosystème international. Tardivement adoptée par le Maroc par rapport à d’autres pays arabes, elle peine à convaincre un public plus large. Les produits restent peu diversifiés, la pédagogie auprès des usagers insuffisante, et de nombreuses incompréhensions persistent.
Pourtant, le potentiel est immense. À l’échelle mondiale, la finance islamique pèse près de 5 000 milliards d’euros et pourrait franchir la barre des 9 000 milliards à l’horizon 2029. Le Maroc amorce donc une transition stratégique. S’il parvient à mieux vulgariser ses produits, à renforcer la confiance du public et à innover, il pourrait capter une part significative de ce marché en plein essor.