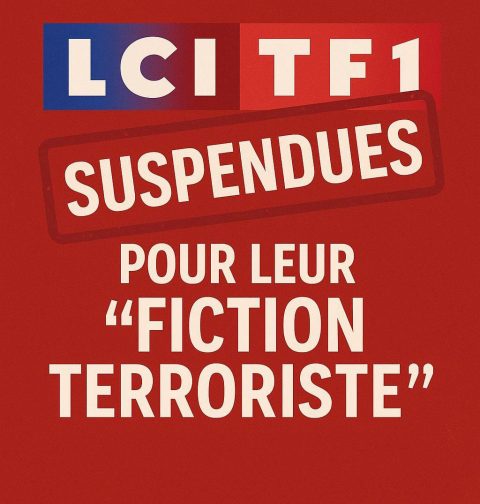L’arrestation de Richard Boni Ouorou, figure intellectuelle et politique controversée, le 15 mai dernier à Cotonou (Bénin), n’est pas un simple fait divers. C’est une onde de choc dont les répliques continuent de secouer la société béninoise. Interpellé pour corruption présumée d’agents du ministère de l’Intérieur en vue de l’obtention du récépissé de son parti Le Libéral, l’homme n’a pas seulement entraîné dans sa chute des fonctionnaires il met aussi à nu les fissures morales d’une nation entière. À travers une tribune incisive, Léopold Gnonke, intellectuel respecté et observateur lucide de la vie publique, soulève une série d’interrogations fondamentales : non pas sur la culpabilité ou non de l’accusé la justice tranchera mais sur ce que cette affaire révèle du rapport des Béninois à la corruption, à l’éthique et à la responsabilité politique.
Trois réactions, un même symptôme
Sur les réseaux sociaux et dans les cercles d’opinion, les réactions se répartissent en trois grandes catégories, note Léopold Gnonke : l’indifférence désabusée, le soupçon de complot politique, et l’indulgence banalisante. C’est cette dernière sans doute la plus répandue qui préoccupe l’auteur. Il la qualifie de « poison lent », capable d’éroder à petit feu les fondements de la République. « Certains, dans un relativisme condamnable, en appellent à la célèbre parabole de la Bible : “Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre” », écrit-il avec amertume, déplorant une société où la corruption n’est plus perçue comme un scandale, mais comme une norme officieuse, presque culturelle.
Une classe politique sous silence
Depuis les révélations, les partis politiques, toutes tendances confondues, observent un silence embarrassé. Aucune prise de position publique, aucun communiqué, aucune condamnation officielle comme si cette affaire, pourtant grave, ne méritait pas l’attention de ceux qui prétendent incarner l’éthique républicaine. Faut-il y voir de la prudence stratégique ou une solidarité implicite ? Dans un pays où les procédures d’enregistrement de partis sont souvent obscures et soupçonnées d’être instrumentalisées, l’affaire Ouorou pourrait bien être un miroir tendu à toute la classe politique.
La République et ses contradictions
Richard Boni Ouorou, de son côté, n’est pas un inconnu. Intellectuel francophone formé à l’étranger, essayiste aux ambitions présidentielles déclarées, il a récemment suscité la controverse en publiant une tribune dans Forbes Afrique, présentée par ses partisans comme une reconnaissance internationale et par ses détracteurs comme une opération de communication payante aux airs de faux-semblant. « Un article payé sur Forbes Afrique n’est pas une carte d’accès à la Présidence de la République », tranche Gnonke. Une mise en garde contre l’illusion que les raccourcis médiatiques peuvent remplacer la légitimité politique acquise par le mérite, l’engagement citoyen et l’intégrité.
Vers un effondrement moral ?
Le fond du propos de Gnonke est moins une attaque personnelle contre Ouorou qu’un cri d’alarme collectif. « Sur un matelas de médiocrité morale, il n’y aura ni justice, ni paix, ni développement durable au Bénin », prévient-il. Il cite l’exemple de nations comme Singapour ou la Corée du Sud, qui ont fait le choix assumé de la rigueur et de l’exemplarité à des moments décisifs de leur histoire. Et s’interroge : le Bénin est-il prêt à emprunter ce chemin exigeant ? Ou continuera-t-il à tolérer les compromissions qui, lentement mais sûrement, ruinent toute espérance d’un avenir commun ?
Une affaire, un test
L’affaire Richard Boni Ouorou, au-delà de son traitement judiciaire, constitue un test. Un test pour la justice béninoise, bien sûr. Mais aussi, et surtout, un test pour la conscience collective d’un peuple. Va-t-on détourner le regard ? Justifier ? Se taire ? Ou, au contraire, affirmer haut et fort que la République mérite mieux ? Dans les semaines à venir, la manière dont cette affaire sera instruite, comment les institutions réagiront ou non et l’attitude de la société civile face à cette épreuve morale pourraient bien peser lourd sur la qualité de notre démocratie.
Car c’est là, au fond, toute la question que pose Léopold Gnonke : voulons-nous un État de droit ? Ou un État de passe-droits ?
Voici ici l’intégralité de son message 👇👇👇
« Mes interrogations sur le cas Richard Boni Ouorou
L’arrestation, ce jeudi 15 mai 2025, de Richard Boni Ouorou, et de certains cadres du ministère de l’Intérieur, a suscité une vive effervescence sur les réseaux sociaux et dans l’opinion publique béninoise. Dans la foulée, on nous apprend que l’homme politique s’est fait épingler pour avoir corrompu des fonctionnaires pour obtenir le récépissé de reconnaissance officielle de son parti politique, Le Libéral.
Si les partis politiques se sont carrément tus jusqu’à présent, trois grands types de réactions émergent au sein des Béninois : i) ceux qui s’en moquent ou détournent le regard, ii) ceux qui y voient de grosses ficelles d’un complot politique, et enfin iii) ceux qui banalisent la corruption d’agent public et lui retirent toute gravité morale et juridique.
C’est cette dernière catégorie qui m’inquiète le plus. Certains, dans un relativisme condamnable, en appellent à la célèbre parabole de la Bible: “Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre”à Richard! D’autres soutiennent que la corruption d’un agent public est une pratique généralisée, presque culturelle, et que s’en prendre à Richard, c’est faire preuve de méchanceté sélective dans un pays où, selon eux, tout le monde triche. Pire encore, certains vont jusqu’à justifier l’impunité au nom de la générosité supposée de l’accusé, comme si la largesse pouvait absoudre l’infraction.
Mais cette indulgence aveugle est un poison lent qui finira par détruire nos instituons, nos acquis sociaux, et même nous mêmes. En légitimant la corruption, on valide insidieusement toutes les formes d’atteinte à l’éthique : le vol, la fraude, le trafic, le crime, les arrangements douteux. On ouvre un boulevard à une génération de criminels prêts à se livrer à toute pratique pour ramener quelques billets à la maison, peu importe leur provenance.
Oui, la présomption d’innocence est une pierre angulaire de notre système judiciaire, mais elle ne saurait être détournée pour neutraliser la rigueur morale et éthique que nous devons exiger de ceux qui prétendent servir la République. Richard ne devrait-il pas savoir qu’un article payé sur Forbes Afrique n’est pas une carte d’accès à la Présidence de la République et que la politique est un fleuve aux puissantes vagues qu’on ne traverse qu’avec des bouées de sauvetage?
Dans cette société où les lignes entre le bien et le mal deviennent indistinctes, peut-on encore rêver d’un avenir collectif fondé sur l’intégrité, l’effort et le mérite ? Là où l’argent sale est célébré, les vocations honnêtes s’estompent au lieu d’être le fer de lance du développement que nous désirons.
Si aujourd’hui nous célébrons l’émergence de pays comme Singapour, la Corée du Sud ou la Chine, c’est parce qu’à un moment charnière de leur histoire, ces nations ont fait le choix douloureux mais salutaire de l’exemplarité, de la discipline, et du rejet des compromissions morales. Elles ont misé sur la rigueur comme levier de transformation. Mais mon pays le Bénin n’en veut pas ! Il en est sérieusement réfractaire!
Alors, que faisons-nous ? Allons-nous regarder, impassibles, le Bénin sombrer dans un chaos moral qui prépare l’apocalypse institutionnelle et économique ? Ou allons-nous, enfin, dire non à la banalisation de la corruption, non à la complicité silencieuse, non au sacrifice de l’éthique sur l’autel du cynisme politique ?
Sur un matelas de médiocrité morale, ou dans un marécage où tout est en décomposition , il n’y aura ni justice, ni paix, ni développement durable au Bénin.
Gnonke Léopold »